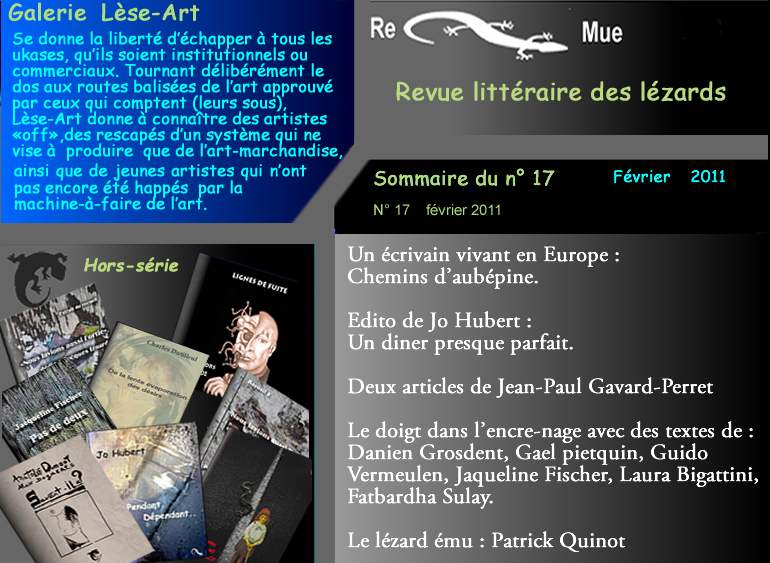Chemins d'aubépine
Voici ce qu'aurait pu nous insuffler, avant de mourir sous les balles, la torture ou se suicider, un de ces jeunes Tunisiens en désespoir et qui vivent la répression sanglante de la dictature policière, comme la subit tout un peuple actuellement et en cours de ces dernières semaines.
« Mes rêves vont ainsi, de courbe en spirale, d'effondrement en vertige. Par-ci où la vie se risque, par-là où l'ennui dans ses élans barbares, l'invalide. De ricochet en ricochet tout me revient, dans mes présences opaques ou mes absences virevoltantes et la chape de silence anonyme et volatile qui s'y mêle. Bien plus encore, vu que cela manque d'audace et de maquis, rien ne suffit à envisager les possibles, les géométries troubles qui arpentent mes intuitions et mon vivre difficile.
La vie, les événements, les instants font à chaque fois de mon être un autre. Là, je suis né. Là, je suis mort. Ce n'est qu'une histoire de temps, de regard et rien ne pourra nous pacifier, le je ne sais quoi vivre et moi-même. Je sais, qui je suis et d'où. Je suis dans des promesses non tenues, ni dociles ni cabrées. J'oublie et me souviens dans des langues qui se font les croisades, à tout bout de champs. Je ne suis ni de hier ni d'aujourd'hui. Ni d'ici ni de là-bas des rives de l'eau. J'ai de la nuit son cerceau, à l'idée que mon seul refuge était l'obscurité et la parole du vent. La brume froide et grise était ma demeure et les odeurs venant de la terre portaient des bribes de ma présence.
Je suis aux prises avec l'instant, avec ce qu'il raconte, choisit, donne à voir, à réfléchir, à s'interroger et à écouter les voix, les vibrations et les cris aigus, déchirés, venus de près et de loin. Ma respiration interroge, arpente les rides secrètes de mon être et n'hésite pas à refaire les chemins et leurs niches étranges. La dissonance cabrée de ma respiration se voit une inclinaison où mon propre récit est habité par d'autres voix, souffles et chemins, ceux des plus intimes inquiétudes et des plus intransigeantes douleurs.
J'ai juste assez de pensées et de fragments, dans chaque révolte et colère où je réapprends à marcher, respirer, à voir, à la fois, faire trace et la faire disparaître par peur. Réapprends à écrire, à lire, à courir avec ce qui naît et meurt en moi et en le monde. Au bord de mes yeux ou de mes lèvres - je n'en sais rien - juste assez de morts et de vivants pour que tout s'y confonde et tournoie au-delà des lignes de mes yeux, plus loin que mon souffle, par-delà mes épaules. Tout, où rien n'est sûr, mortel, chose nue, comme un fleuve fiévreux et colérique dont les rives s'effondrent et emportent les amarres de quelques voix humaines s'empêchant l'une l'autre de se noyer.
La vie va ainsi et mes illusions aussi. Oublieuse mémoire, elle me tient captif depuis les premiers jours par l'entière douleur éparse, irrigue mes traces, mes pas, mes ombres. Est-ce un mort qui parle? Est-ce ma mort qui tutoie la sienne? Est-ce mon corps, par trop de fatigue et ne sachant rien de moi, égaré, me fait signe?
Avec ses longs bras et son visage raviné, creusé de rides et ses grandes mains qui ne bordent plus que le vent. Je le vois venir avec la crue, ses pas forcent la blessure comme la grâce, cordée tendue, la douceur du chaos. Il apprivoise les formes confuses sans pudeur, s'affine entre colère et mystère.
Est-ce moi?
Mon visage ignore tout du jour et de la nuit, semble surgir momifié vers la soudaineté des espaces, des temps et l'étrangeté du vivre.
Est-ce moi qui se déracine et ne s'attable plus en face de ce qui peut nous survivre, face à des lueurs, à des pas, à des berges, des mottes d'amour, des nuits, des maisons, des yeux aux regards purs, face à ce que porte l'humain au plus haut et plus fastidieux de ses dépouilles.
Chaque motte de terre, l'abreuver de dissidence tant que mon corps respire l'eau, la pierre, le ciel, le jour, la lumière, la douleur, la fatigue, la mienne et celle des étoiles. Chaque regard, scintillant comme un papillon, indescriptible, le border de tendresse et de hasard jusque ce que le vent se lève et démembre l'injustice des hommes. Injustices qui brillent, tendues vers le jour, vers la nuit, vers les eaux mortes pour hâter le silence, pour vénérer la face obscure de la roche, donnant sa forme à des lèvres inclinées qui empestent la peur et la prière. Murs, nébuleuse aurore, éparse, mortifiée. Ils débouchent sur le vide, donnant leurs formes, pauvrement, aux mensonges des hommes.
Murs que chaque battement de cil approuvant la mort, fortifie une entente insoutenable et un assaut contre la vie. Combien faut-il de nuit pour que chaque respiration devienne débarcadère de désobéissance?
Me trouvant au sein d'une vaste nuit étrange, en figure de soir précaire, en cerceau poussé par les vents, au-dessus de terres fourbes et offusquées, peuplées de présences invisibles. Une nuit aux visages emmurés, nul horizon alentour, rien sous les amandiers, ma solitude flambe dans le plus haut brasier. Une nuit dont il faut essayer de passer à travers, sans tarder. Passer je ne sais où comme à travers les autres nuits, devenues aussi étroites que le jour. Les vents en spirale donnent sur des quais où ne se trouve plus personne. Mais j'avançais si condamné. On ne revient pas de ce genre de capture, si nette, si claire, si définitive. D'ailleurs revient-on de quoi que ce soit? De jour comme de nuit. L'un galope dans l'autre. Mes colères, traquées, à brûler plus que de vide et de noir, mais décidées à ne pas mourir, se sont endurcies comme des hanches fraîches, devenues si semblables, si jumelles, en fugue, joyeuses comme des braises, rampantes, en cortège boiteux.
De mon côté, j'ai toujours confondu les distances et les espaces, non qu'ils me sont étrangers ou énigmatiques ni leur lèvres subtiles. Les terres sont-elles si larges, me disais-je, si vastes, si déroutantes, si immobiles, si exiguës? Terre à l'étroit, aveugle dans l'ouïe, figure sourde en plein jour, balafre sonore, aile, absence, nouvelle, en plein cœur, flamme, proie, instant qui glisse, sans détour, lisse jusque le déjà vu, le déjà songé?
Je vois donc arriver ces hommes et ces femmes et leurs fougues, leurs bestiaux, leurs enfants, leurs racines et projets. Leur peau blanche à la traîne. Ils tissent des archipels de rêves à d'autres, déroutent les reliefs et posent des pierres sur pierres auxquelles ils finissent par ne plus y croire. Tout était fragile, frémissant, émietté face au large, à travers vent et blessures, cette façon d'approcher ce qui est à saisir. Tenté par ce dehors, par ce là-bas des rêves, par ces naissances renouvelées, au timbre étrange et libre.
Je me suis imaginé papillon parmi ces résistants, compagnons du vent et ses bourrasques. J'ai aimé
ce peu, cette infinie aspiration du vide comme ce sentiment infini qui vous conduit aux confins de l'absurde. Un sablier sans sable éclairait mon exil en eux.
Autour de moi, le long de ces révoltes et voyages, des profondes tristesses, des vies lasses dans les secrets des nasses, dans les tranchées des héritages, dans les silences des peurs et des terreurs. Une idée de la mort taraude. Une autre idée aimante cette fois-ci, de résistance, sans dire, sans prévenir, vient comme pour faire place à mes ultimes désirs, façonne, construit, emplit, habille le plus lointain de mes désastres.
A croire mon sommeil et ses rabais, il s'agit là certes d'une certaine idée de la vie. Une sorte de présence qui m'invite juste pour un bref instant nu, tout nu, dans lequel se résume l'entièreté du néant.
De halte en halte, ailleurs, plus loin, en quête de tout et de rien, peut-être, pour des prunes, sans parvenir à tout comprendre ni à saisir et le faut-il, dans le jour, dans la nuit noire, les mots s'écartent,
les lumières s'amenuisent et les dernières rumeurs humaines s'altèrent. Encore longtemps, sans détours ni ornement, sur le chemin, je porte le clapotis de mes naissances dans mes pas. Je calme mes vertiges dans la lente figure de la fatigue. Hormis une douce glissade vers un lendemain peu
sûr, mon cri trépigne aux pieds de quelconques murs ombragés par de grandes catastrophes. Sur l'une des rives, la solitude du passeur égalait ma lassitude. Sur une autre, ma voix trahissait la patience qui fortifie l'attente. Ailleurs, l'usure des poussières finit par agacer le fusil du vigile.
Parmi nous, jusqu'au jour, jusque ailleurs, au bout, ce manteau de terreur comme une main froide, glaciale, parmi une absence jusqu'au cœur, jusqu'à l'os. Sa trace creusée dans le vent, dans le souffle de mon cri, parmi mes ramifications comme pour hâter l'effroi à bout de force. Nulle part ou contre le cœur étrange du silence qui écorche la pierre. Sur les berges dénudées des fureurs, ma colère se montre nue dans son corps comme elle balbutie dans le mien. Nos lèvres se sont connues en chemin, quand bien même, comme aux premiers aveux d'un puceau, nous déroberons la mort à la mort. Tout glisse avec l'aube comme un rapide de la peur. Tout s'ajoute et se soustrait avant les blessures. Les traces haletantes entre les haies d'un animal blessé. Venu du froid comme une corvée sur terre, dans le fracas quotidien jusque aux parois de ce qui n'existe. Indescriptible, ce tout lisse, quand le vent se lève pour d'autres soucis, disparait pour ne laisser de traces que la proximité du murmure et les brèches de quelques remous. »
|
![]() Cliquez-ici-menu de la revue-
Cliquez-ici-menu de la revue-